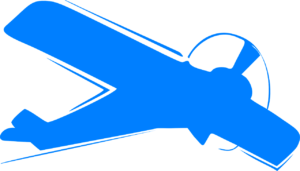.
Sur les traces de Jack London
.

Je n’étais aucunement prédestiné à me passionner pour la vie et l’œuvre de Jack London, pas plus qu’à celles de Salinger. Si, en 2004, on m’avait prédit que j’allais consacrer au premier un livre, un scénario, des conférences et même réaliser un film aux États-Unis, j’aurais haussé les épaules. Et si on m’avait précisé que ce tournage allait me faire entrer dans l’univers privé de l’écrivain J D Salinger, j’aurais fait un signe de l’index sur la tête. En réalité, ma vraie découverte de Jack fut plutôt tardive. Durant l’été 2005, j’étais en voyage touristique à San Francisco avec ma compagne. Alors que nous découvrions la Californie, celle-ci me parla d’un site touristique dans la Sonoma Valley prisé dans le Guide du routard, le Jack London State Historic Park où se trouvait Glenn Ellen, le ranch où vécut et mourut l’écrivain américain le plus célèbre du monde.
J’avais bien quelques références relatives à cet écrivain, mais elles remontaient à mon adolescence avec la lecture au collège de L’Appel de la forêt ou de Croc-Blanc. De mémoire, le style direct, vivant et efficace de l’écriture m’avait séduit à l’époque, mais il s’agissait pour moi de l’œuvre littéraire d’un écrivain animalier. C’est dans son ranch que j’allais découvrir le vrai visage de Jack London, à la fois un aventurier de l’écriture et un écrivain de l’aventure qui puisait précisément la source de son inspiration dans les chapitres romanesques de sa propre vie.
Arrivés sur le parking du mémorial de Glenn Ellen, nous avions débuté notre visite par la maison de Charmian, la veuve de Jack London, dont le domicile avait été transformé en musée. Et là, j’eus un véritable choc. Sur deux étages, plusieurs panneaux d’exposition et vitrines restituaient la vie et l’œuvre de l’auteur de L’Appel de la forêt. Loin d’être un simple auteur animalier, je découvris l’itinéraire d’un authentique aventurier qui vécut cent vies et devint un écrivain engagé. Une enfance de labeur dans la pauvreté, un bagarreur débrouillard qui fut un temps pilleur d’huîtres dans la baie de San Francisco, puis vagabond enfermé en prison, ouvrier exploité, trimardeur des routes et des rails aux États-Unis, chasseur de phoques avant de devenir chercheur d’or en Alaska, marin bourlingueur des mers du sud, fermier… À travers les textes et photos exposés, je découvrais que cet enfant des docks avait réussi à se hisser par autodidaxie et la seule force de sa volonté au rang de l’écrivain américain le plus lu au monde.
En visitant les salles du musée, je découvrais des objets personnels de l’auteur et de nombreuses photographies, je réalisais que sa vie ressemblait bien à ses romans ou l’inverse. Je découvrais aussi qu’il avait été un correspondant de guerre et un reporter photographe extrêmement talentueux, la Huntington Library de Los Angeles conservant encore plus de 12 000 clichés portant sa signature. Il avait aménagé à bord de son voilier, le Snark, son propre laboratoire de développement. Des clichés incroyables de réalisme et de vie, comme le furent ses romans. Mais l’écrivain des neiges, des océans et de la vie, était surtout l’écrivain des luttes : celles avec soi-même, celles qui opposent l’homme aux forces de la nature, à l’injustice des hommes, à l’égoïsme des possédants. Militant socialiste ayant percé grâce à sa plume qui transmit une cinquantaine de textes politiques, je découvrais qu’il avait été deux fois candidat à la mairie d’Oakland. Un rebelle qui avait bien du Boissel en lui.
Dans une vitrine étaient exposés les 60 exemplaires originaux de son œuvre bibliographique. Loin d’être seulement un romancier pour la jeunesse, Jack avait été l’auteur d’ouvrages politiques très engagés, de romans d’aventure, fantastiques, policiers, d’une pièce de théâtre, d’un scénario de film pour Hollywood… Le feu, le brio, la désinvolture du génie caractérisaient toute son œuvre. Dans une vitrine figuraient quelques lettres de refus d’éditeurs ainsi que la liste des 600 refus de publication que Jack London reçut de la part d’une centaine de maisons d’édition avant qu’il ne rencontre le succès et la célébrité. L’homme était sacrément opiniâtre.
Les sagaies, flèches et autres masques polynésiens accrochés sur les murs témoignaient de ses périples exotiques. Je regardais les photos de Jack en tenue de trappeur, Jack sur sa monture en cow-boy, Jack à la barre d’un voilier, Jack en tenue de reporter avec son appareil photo, Jack au volant de son cabriolet Pierce-Arrow, Jack en pantalon de golf… « Jack en pantalon de golf ! » mais bon sang, mais c’est bien sûr ! Jack London, l’aventurier reporter, était de toute évidence le précurseur de… Tintin ! Tout faisait sens dans mon esprit, mais pourquoi donc Hergé n’avait-il jamais reconnu la source d’inspiration de son personnage ?
Au rez-de-chaussée, on pouvait visionner de petites vidéos montrant de courts films d’époque : Jack à cheval, jonglant et faisant des pitreries, câlinant des porcelets… Une magnifique maquette de son yacht trônait dans une vitrine ainsi qu’une autre de la Wolf house, sa gigantesque demeure de milliardaire qui brûla en une nuit, la veille de son aménagement. Un incendie criminel dont on n’identifia jamais les auteurs. Il y avait aussi dans un cadre son acte de décès qui soulevait beaucoup d’interrogations, tant il était en contradiction avec les échos de la presse. Accident, maladie, suicide, meurtre… Ses origines familiales étaient mystérieuses, les conditions de sa mort le resteront tout autant.
Nous décidâmes de quitter le musée pour aller voir les ruines de la Wolf house puis le cottage, le logement où Jack London écrivit ses derniers livres et finit sa vie. Je découvrais, en chemin, les vestiges de son domaine agricole où il s’employa sur la fin de sa vie à mener le travail d’un fermier écologiste avant la lettre. Nous passions à côté d’un champ de cactus sans épines, une expérience agronomique qu’il avait développée pour trouver une nourriture de substitution pour les bêtes. Il y avait un lac artificiel qu’il avait créé pour en faire un vivier à poissons et une réserve d’eau pour le ranch. Je découvrais aussi son palais idéal pour cochons, dont il avait entièrement conçu l’architecture afin d’améliorer le bien-être des animaux. Les ruines de la Wolf house étaient grandioses et dévoilaient ce qui aurait dû être un véritable palais de milliardaire consacrant aux yeux du monde entier sa brillante réussite sociale et littéraire. Visiblement le gosse des docks, l’écrivain gaucho qui avait fait fortune par l’audace et la force de sa volonté avait voulu battre le capitalisme à son propre jeu.
Je ressentis une vive émotion dans le cottage où tout avait été préservé ou reconstitué à l’identique. On découvrait l’habitat où Jack avait vécu, le jardin privé, la cuisine, le séjour, la chambre où il décéda et surtout son bureau, là où il travaillait, téléphonait, écrivait ses livres, tantôt à la main, tantôt à la machine tout en écoutant parfois de la musique sur un gramophone resté en place. Je reconnaissais des photos vues au musée, tout était en place, avec des papiers, du courrier, des livres, des journaux, deux machines à écrire, un grand fauteuil pivotant dont on avait l’impression que l’occupant venait tout juste de quitter la pièce. Je n’eus pas du tout le même ressenti que celui de la visite du musée. Alors que nous n’étions que deux, ma femme et moi, nous ressentions le besoin de chuchoter comme si nous ne voulions pas déranger. Ce lieu était à mes yeux clairement habité et de fait, j’avais l’impression d’être un intrus dans un sanctuaire. Nous quittâmes les lieux sur la pointe des pieds.
En revenant vers la voiture, nous nous séparâmes, j’étais motivé pour aller sur la tombe de Jack London située non loin dans le parc. En guise de tombe, il s’agissait d’un simple rocher rougeâtre posé au milieu d’une petite clairière, là où ses cendres reposaient. Une citation de Jack lue au musée me revint à l’esprit : J’aime mieux être un météore superbe plutôt qu’une planète endormie. La fonction de l’homme est de vivre, non d’exister. Je ne gâcherai pas mes jours à tenter de prolonger ma vie. Je veux brûler tout mon temps. Comment ne pas penser à cette citation devant ce rocher rouge qui évoque une météorite tombée du ciel. Mort à quarante ans, brisé par la gloire et les excès, consumé par sa propre énergie, Jack London, tel un météore, avait traversé le ciel de la littérature américaine, illuminant celle-ci de mille feux.
L’esprit de Jack London m’avait durablement capté et j’allais venir trois fois en six ans dans la Sonoma Valley rien que pour lui. Je me mis à dévorer tous ses livres et la motivation pour me lancer à mon tour dans l’écriture n’eut de cesse de grandir. Outre mes autres projets d’écriture sur Joyeuse, Boissel, etc, j’écrivis sur Jack London un projet de roman mi-fantastique mi-policier. Celui évolua en un scénario de film qui se concrétisa par un tournage improbable durant les étés 2011 et 2012. Dans la continuité de la réalisation du film Boissel, nous avions décidé de former une petite équipe de tournage et d’aller tourner aux States THE film sur Jack London avec le même chef opérateur de talent, Vincent Aubert, la même actrice principale Charlotte Duthoy, et dans le rôle de Jack celui qui avait joué Boissel. On n’est jamais aussi bien servi que par soi-même… Mais à la différence du tournage Boissel, nous allions cette fois expérimenter les charmes du Guerilla film making !
Il faut comprendre dans cette dernière appellation, qui pourrait faussement avoir des relents hollywoodiens, qu’il s’agissait de tourner un film à l’arrache, en mode système D avec une équipe qui tenait dans une voiture, sans le sou, sans autorisation bien sûr, et la plupart du temps dans des lieux interdits. Voici donc le contexte planté, nous avions certes un scénario et un embryon de plan de tournage mais il fallait s’adapter et surtout improviser. Notre équipe de tournage se limitait donc à quatre ou cinq individus, les trois Pieds nickelés ardéchois, et un ou deux complices français vivant sur place en Californie ou dans le Colorado. Quand nous avions su que le National Park Jack London nous demandait une assurance d’un million de dollars pour venir tourner notre petit film sans budget, nous savions que nous allions devoir faire preuve de beaucoup d’astuce pour aller sur place et contourner les problèmes. À cette fin, il nous fallut détourner l’attention des rangers, enjamber des barrières de sécurité et aller tourner en direct là où l’on n’avait pas d’autorisation…
Il y aurait eu un making-of extrêmement drôle à faire sur ce tournage tant l’aventure humaine fut égrenée des plus abracadabrantesques incidents. Entre de multiples interpellations par des policiers, rangers ou vigiles, de singulières rencontres d’individus parfois sympathiques, parfois très inquiétants, la phobie de notre chef-opérateur pour les serpents, des désaccords tendus sur l’emploi de la carte routière ou du GPS, un ours croisé dans les montagnes du Colorado, une débandade en catastrophe de toute l’équipe face à une nuée de moustiques agressifs et d’inévitables tensions apparues entre les membres de notre petite équipe mixte. Au final, le rendu cinématographique du film, disponible sur YouTube, se révéla à la hauteur qualitative du film Boissel. C’est précisément cette deuxième histoire dans l’histoire, celle du tournage, qui me donna la matière et l’envie d’écrire en 2012 un nouveau scénario de film qui aurait relaté le tournage improbable d’un film aux USA par une poignée de frenchies téméraires : A la poursuite de Salinger. Mais que vient faire Salinger là-dedans ? me demanderez-vous. Nous y voilà et la réponse tient en deux mots coïncidences et Golden Gate. (suite du récit dans l’article sur Salinger)
________